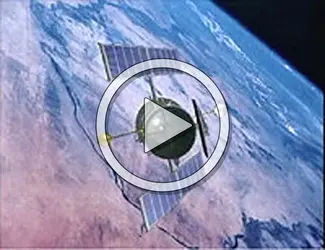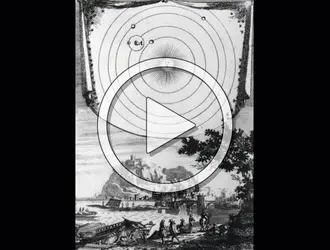UNIVERS (notions de base)
Article modifié le
Observer l’Univers
L’image populaire de l’astronome est celle d’un homme posté derrière son télescope, l’œil rivé à l’oculaire ; mais il n’y a plus guère que les astronomes amateurs pour adopter cette attitude. Les scientifiques, assis devant leur ordinateur, examinent l’Univers dans tous les domaines où celui-ci nous envoie des signaux, là où la lumière visible ne l’est presque plus, et pour lesquels il est difficile de pénétrer l’atmosphère.
Les télescopes optiques
Les grands télescopes qui ont ouvert la voie à la cosmologie moderne, ceux du mont Wilson et du mont Palomar en Californie, mais aussi celui de l’observatoire du pic du Midi dans le sud de la France, continuent certes à fonctionner activement, mais une nouvelle génération d’instruments beaucoup plus performants a été mise en place dans les toutes dernières années.
Les améliorations qu’on en exige portent sur l’aptitude à discerner des objets de plus en plus minuscules et de moins en moins lumineux. Pour atteindre ce résultat, il faut s’affranchir des turbulences qu’introduit l’atmosphère, et construire des instruments très grands.
Il existe deux solutions au premier problème : observer hors de l’atmosphère, ce que fait le télescope Hubble, installé dans un satellite qui tourne à 600 kilomètres d’altitude, ou corriger les défauts dans l’image qu’introduit l’atmosphère en remodelant en permanence le miroir du télescope, ce qu’on obtient par la technique de l’optique adaptative.
C’est à l’ensemble de ces instruments que l’on doit, entre autres, l’observation de galaxies très lointaines mais aussi de zones spécialement actives de notre Galaxie, où se produit la naissance de nouvelles étoiles.
Une bonne façon d’observer certains objets éloignés consiste à s’en rapprocher, ce que font depuis les années 1960 de nombreuses sondes spatiales qui ont visité presque tous les corps du système solaire, soit en les survolant, soit en se posant dessus.
Voir l’invisible
La radioastronomie, née après la Seconde Guerre mondiale grâce aux progrès technologiques issus du radar, a ouvert la voie à l’observation extrêmement fructueuse d’objets cosmiques qui n’émettent aucune lumière visible, mais des ondes hertziennes de courte longueur d’onde. Les radiotélescopes, dont il existe deux types, sont les instruments les plus adaptés à ces études.
Certains comportent une immense surface immobile de plusieurs centaines de mètres de côté en forme de miroir concave qui concentre les ondes vers un récepteur. D’autres sont formés d’un ensemble de récepteurs mobiles semblables à de gros radars qui observent simultanément la même source.
La radioastronomie a notamment permis de mettre en évidence des sources cachées à notre vue par d’épais nuages de gaz et de poussières mais transparents aux ondes hertziennes. On a ainsi découvert ces « monstres préhistoriques » que sont les quasars.
L’astronomie infrarouge permet d’observer les objets dans des longueurs d’onde supérieures à celles de la lumière visible, qui ont, comme les ondes hertziennes, l’avantage de traverser des milieux opaques et donc de révéler des structures ou des détails invisibles autrement.
Les télescopes infrarouges utilisent en général des optiques voisines de celle des télescopes optiques, mais les détecteurs sont spécifiques.
Parmi les résultats les plus spectaculaires des astronomies radio et infrarouge figure la mise en évidence du fond diffus cosmologique, rayonnement qui baigne tout l’Univers et qui porte le témoignage des premiers moments de son histoire, à peine 300 000 ans après le big bang.
À cause de l’opacité de l’atmosphère pour les longueurs d’onde plus courtes que celle de la lumière visible, l’observation dans les domaines de l’ultraviolet, des rayons X et du rayonnement gamma ne peut se faire qu’à partir de ballons-sondes et de satellites en orbite terrestre munis de détecteurs de très haute technologie.
Ceux-ci ont apporté des informations fondamentales sur la nature et le fonctionnement des trous noirs, ainsi que sur les mystérieux sursauts gamma.
Capter l’imperceptible
Tous les signaux dont nous venons de parler appartiennent au spectre « électromagnétique ». D’autres signaux, très difficiles à capter, nous parviennent aussi, et leur observation est un des défis du xxie siècle.
Les neutrinos énergétiques sont extrêmement abondants, mais interagissent peu avec la matière, ce qui les rend difficiles à observer. Pour cela, on utilise des cibles de grande masse qui doivent être blindées contre le rayonnement cosmique.
En effet, ce dernier bombarde constamment tout site terrestre et représente un bruit de fond important. D’immenses réservoirs d’eau enfouis sous terre et entourés de capteurs ultrasensibles permettent de se prémunir contre ce rayonnement. Une dizaine de neutrinos suffisent à signer une explosion de supernova.
Si la matière cachée (voir Les constituants de l’Univers) est faite de particules exotiques, celles-ci ne pourront pas échapper à la quinzaine de détecteurs répartis dans le monde, tous enterrés très profondément, soigneusement protégés de toutes les radiations parasites. Cette veille permanente reste pour l’instant encore vaine.
Témoins de tous les événements violents du cosmos, du big bang aux collisions d’étoiles, des supernovae aux trous noirs voraces, les ondes gravitationnelles sont maintenant scrutées au moyen de détecteurs de plusieurs kilomètres de longueur auxquels on demande de repérer des « rides » de l’espace-temps dont l’amplitude est inférieure au diamètre d’un noyau d’atome. Y parviendront-ils ?
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Voir aussi
- SUPERAMAS DE GALAXIES
- NUAGE INTERSTELLAIRE
- SUPERNOVAE
- GROUPE LOCAL
- HERTZSPRUNG-RUSSELL (HR) DIAGRAMME
- RADIOTÉLESCOPES
- ÉTOILES À NEUTRONS
- COSMOGONIE, mythe
- PLANÉTÉSIMAUX
- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité
- ÉNERGIE NOIRE ou ÉNERGIE SOMBRE
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- FOND DIFFUS COSMOLOGIQUE ou RAYONNEMENT COSMOLOGIQUE
- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'
- AMAS GLOBULAIRES
- HUBBLE-LEMAÎTRE LOI DE
- EXPANSION DE L'UNIVERS
- TÉLESCOPE SPATIAL
- SATELLITES D'OBSERVATION ASTRONOMIQUE
- SONDES SPATIALES