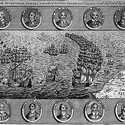VOILIERS
Article modifié le
La physique du voilier
La physique du voilier recouvre les allures, la stabilité du voilier, les forces aérodynamiques et hydrodynamiques pour trouver la vitesse et le cap optimaux.
Les allures
Le terme « allure », lorsqu'il concerne un navire ou un voilier, sert à définir l'orientation de la route suivie par le bateau par rapport à la direction du vent (fig. 2).
La stabilité
Il est permis de dire, par une formule raccourcie très expressive, que la stabilité est la force propulsive du voilier. En effet, un voilier ne peut supporter de surface de voilure, ou ne peut donc disposer de force propulsive, que dans la mesure où sa stabilité le lui permet.
La stabilité se mesure et s'exprime par le moment du couple de redressement, c'est-à-dire par le produit du poids du navire multiplié par la distance entre le vecteur poids appliqué au centre de gravité et le vecteur poussée hydrostatique d'Archimède appliqué au centre de carène, c'est-à-dire au centre géométrique du volume immergé. La courbe de redressement du voilier est la courbe des moments de redressement en fonction des différents angles de gîte (inclinaison latérale du voilier). Une même stabilité (c'est-à-dire un même couple de redressement) peut être obtenue par un grand poids et un petit bras de levier (exemple du voilier de commerce ou du yacht monocoque, fig. 3, 4 et 5) ou, au contraire, par un petit poids et un grand bras de levier (exemple du yacht multicoque, catamaran ou trimaran).
La stabilité d'un voilier est étudiée du double point de vue des performances et de la sécurité. Ainsi, une augmentation de la stabilité aux faibles angles, jusqu'à 300 environ, est un facteur de vitesse aux allures proches du vent ; alors que l'augmentation de la stabilité aux grands angles, et jusqu'à 1800, a surtout une influence sur la sécurité dans des conditions de navigation critiques.
L'étude de la courbe de redressement d'un voilier est fondamentalement analogue à celle d'un navire quelconque. Selon le type de voilier, on obtient des courbes de redressement très différentes (fig. 6). Plusieurs paramètres les décrivent et parmi ceux-ci principalement l'angle de chavirement statique (angle pour lequel le couple des forces de gravité et d'Archimède s'inverse et devient couple de chavirement). Cet angle peut être de l'ordre de 1200 à 1400 pour les voiliers de plaisance de série à quille lestée. Pour les racers des séries internationales, il arrive que le chavirement statique soit impossible. En outre, l'aire de la partie positive de la courbe des moments de redressement traduit la résistance à l'impact d'une vague ou à celui d'une rafale de vent ; alors que l'aire de la partie négative de la courbe (partie grisée, fig. 6) caractérise la stabilité en position chavirée. Cette dernière doit être minimisée pour que l'équilibre en position chavirée soit très instable.
Les multicoques, catamarans, trimarans et praos ne sont généralement pas lestés et tirent leur stabilité de leur très grande largeur : leur courbe des moments de redressement passe par un maximum très accentué vers 100-300 pour s'annuler ensuite vers 700-900. Du fait de leurs caractéristiques, ils présentent souvent des stabilités longitudinale ou diagonale voisines de leur stabilité latérale.
Pour les monocoques, un accroissement de la gîte a pour conséquence une augmentation de la traînée. D'où l'importance de la stabilité du monocoque aux allures proches du vent où la vitesse maximale, pour un angle de remontée au vent donné, est atteinte à des angles de gîte compris entre 100 et 300.
Les forces aérodynamiques et hydrodynamiques
L'origine de l'énergie propulsive d'un voilier est la transformation par les voiles de l'énergie cinétique du vent. On constate expérimentalement que le fluide est accéléré sur une face de la voile et ralenti sur l'autre. D'après le théorème de Bernoulli, ces différences de vitesses induisent des différences de pressions, une surpression au vent et une dépression sous le vent. La résultante de ces pressions constitue la force aérodynamique soit Fa, appliquée en un point appelé centre d'effort de la voilure. Fa peut être décomposée selon une composante dans la direction du vent apparent Fx, qui est la traînée de la voilure, et une composante dans la direction orthogonale au vent apparent Fz, qui est la portance de la voilure.
Sous l'influence du vent, le voilier se déplace à une vitesse donnée Vs. Il ressent alors un vent relatif en sens opposé — Vs. Le triangle des vitesses montre que le vent apparent Va est la somme du vent réel Vt et du vent relatif — Vs. Cela signifie qu'à vent réel Vt donné, et à angle de remontée au vent vrai γ donné, la vitesse du voilier Vs dépend du seul angle β, entre le vent apparent Va et la route du navire.
La finesse de la voilure Fz/Fx = cotg εa traduit le rapport de la composante utile, qui est la portance Fz, à la composante nuisible, qui est la traînée Fx. La projection de la force aérodynamique totale Fa sur la direction d'avancement du navire, c'est-à-dire la force Fr propulsive disponible, dépend à la fois de la valeur de Fa et de son orientation, fonction elle-même de la finesse.
Pour augmenter cette force propulsive Fr, on cherche soit à augmenter la force aérodynamique totale Fa, soit à améliorer la finesse. Il n'est malheureusement pas possible d'obtenir simultanément une force aérodynamique et une finesse toutes deux maximales. Compte tenu de l'orientation des forces, on cherche à augmenter la finesse aux allures proches du vent, et, au contraire, à accroître Fa aux allures portantes. Sur les voiliers modernes, on obtient une finesse maximale de 4 à 5 et un coefficient de portance maximale de 1,4 à 1,6.
Tout engin flottant à propulsion vélique, que ce soit un navire à carène profonde ou un voilier léger glissant près de la surface, transfère une partie de l'énergie fournie par le vent à la masse d'eau qui l'entoure.
La carène développe ainsi des efforts hydrodynamiques, dont la résultante et le moment sont égaux et opposés à ceux des forces de gravité et des efforts aérodynamiques. En projection, on obtient une résistance à l'avancement R opposée à la composante propulsive Fr et une résistance latérale Fs opposée à la composante de gîte et dérive Fh, et enfin un couple de redressement opposé au couple inclinant. La carène se comporte donc comme un hydrofoil dont l'efficacité sera d'autant plus grande que le rapport Fs/R = cot εh, c'est-à-dire la finesse hydrodynamique de la carène, sera plus grand. L'écoulement autour de la carène et les variations concomitantes de pression (qui sont à l'origine des forces hydrodynamiques) sont déjà complexes pour la carène d'un navire de forme symétrique se déplaçant avec une dérive et une gîte nulles ; elles deviennent encore plus complexes pour un voilier dont la carène gîtée n'a plus une forme symétrique et avance « en crabe » avec une dérive non nulle.
Très schématiquement, la résistance à l'avancement R est la somme des résistances de frottement, de remous, de vagues, de la résistance due à la gîte et de celle qui est induite par la dérive du voilier :

Selon la vitesse, le type de voilier et l'allure par rapport au vent, tel ou tel terme de cette somme peut prendre une importance plus ou moins grande. Les trois premiers termes sont communs à tous les types de navires et représentent l'essentiel de la résistance à l'avancement d'un voilier aux allures portantes. Plus l'allure se rapproche du lit du vent, plus les résistances dues à la gîte et à la dérive s'accroissent. Si l'angle de gîte au près devient excessif, la résistance à l'avancement devient considérable, la finesse de la carène diminue et le voilier « se vautre », selon le terme consacré par l'usage. On comprend mieux ainsi l'importance d'une bonne stabilité, garante de la finesse de la carène à l'allure du plus près.
La résistance latérale à l'allure du plus près (portance) de la carène des voiliers modernes pourvus d'un aileron antidérive distinct de la coque provient, pour l'essentiel, de cet aileron. Sur les anciens navires, clippers, cap-horniers, etc., la carène ne comportait aucun aileron antidérive, et la résistance latérale était procurée par une forme adéquate de la carène elle-même.
La vitesse et le cap optimal
Peut-on concevoir la possibilité d'améliorer indéfiniment la capacité des voiliers à serrer le vent ? L'angle de remontée au vent apparent β est directement lié aux finesses de la voilure et de la carène. Il est cependant impossible d'obtenir simultanément les valeurs maximales de ces deux finesses. À mesure que le voilier accélère, la finesse de la voilure augmente, mais celle de la carène diminue.
En effet, la portance de la carène est proportionnelle au carré de la vitesse, alors que la résistance à l'avancement croît avec une puissance de la vitesse supérieure à deux ; de sorte qu'un voilier rencontre à l'allure du plus près un « mur » de résistance infranchissable, sauf à imaginer un changement radical de conception. Un tel changement a été recherché par l'adaptation de plans porteurs (foils) aux voiliers. Diminuer l'angle de remontée au vent paraît donc extrêmement difficile. En revanche, aux allures portantes, un tel phénomène disparaît et il est comparativement plus facile d'augmenter alors la vitesse.
La simulation du comportement du voilier aux différentes allures peut être entreprise avec des programmes nommés V.P.P. (velocity prediction program) qui sont fondés, d'une part, sur une approche théorique et, d'autre part, sur la mise en équations de données issues d'essais systématiques en bassin. Les résultats sont d'autant plus précis que le voilier étudié a des caractéristiques proches de celles des voiliers utilisés dans la base de données du programme.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- André MAURIC : architecte naval, bureau d'études André Mauric, Marseille
- Jean-Charles NAHON : ingénieur de l'armement (génie maritime), architecte naval, président du bureau d'architecture André Mauric
Classification
Médias
Autres références
-
BRICK
- Écrit par Jacques MÉRAND
- 72 mots
Apparu après 1750, le brick est un petit navire de guerre à voile, son importance étant désignée par le nombre de bouches à feu : brick de douze, de dix-huit canons... Gréé en voiles latines sur deux mâts, il peut devenir un voilier très fin, le brick-aviso, destiné aux missions rapides. Le brick de...
-
FLÛTE, navire
- Écrit par Jacques MÉRAND
- 81 mots
Lourd bateau à voiles, d'origine hollandaise, destiné aux transports de marchandises. Étienne Cleirac mentionne la flûte dans ses Termes de marine (1634) et Colbert évoque les flûtes « à grand ventre », de 300 à 500 tonneaux, « navigués par peu d'hommes vers les Indes orientales ». Un bâtiment...
-
FRÉGATE
- Écrit par Jacques MÉRAND
- 165 mots
Le nom de ce navire léger est emprunté, selon Jal, à un bateau antique, l'aphractum. Il apparaît au xive siècle, dans une lettre de la reine Jeanne, comtesse de Provence, à Bertrand de Grasse (1362). De la famille des galères, la frégate est alors une chaloupe montée par douze rameurs. On...
-
GALION
- Écrit par Jacques MÉRAND
- 178 mots
- 1 média
Apparu au xve siècle, le galion tient de la nef et de la galère. Si le rapport entre la largeur et la longueur d'un vaisseau rond est de 1 à 3, il devient, sur le galion, de 1 à 4 ou 5 ; il est aussi long que la galère dont il conserve, par ailleurs, l'éperon à l'étrave. François I...
- Afficher les 13 références
Voir aussi
- NAVIGATION DE PLAISANCE
- VITESSE
- HYDRODYNAMIQUE
- NAVALE ARCHITECTURE
- FINESSE, aéronautique
- PORTANCE
- TRAÎNÉE
- CLIPPER
- COQUE, technologie
- RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT
- CARÈNE
- VOILES
- CATAMARAN
- YACHT
- HYDRODYNAMIQUE NAVALE
- CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (CAO)
- PLAN DES FORMES, marine
- IOR (international offshore rule)
- PROPULSION VÉLIQUE
- PROPULSION ÉOLIENNE
- MULTICOQUE
- TRIMARAN
- PERFORMANCES, technologie
- PAQUEBOT