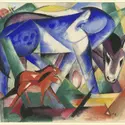KANDINSKY WASSILY (1866-1944)
Article modifié le
Les utopies de la reconstruction
Le « grand déluge » qu'annonce avec une tension croissante la peinture de Kandinsky avant 1914 est suivi d'une apocalypse bien réelle. Mais la guerre marque aussi pour lui une crise profonde ; en 1915, il note pour la première fois dans son catalogue : « Aucun tableau ». À quoi s'ajoute la rupture avec Gabriele Münter. C'est la révolution russe qui paraît enfin annoncer la « résurrection » attendue : Kandisky va devoir maintenant, et jusqu'en 1933, mettre à l'épreuve de la réalité, en Russie puis en Allemagne, le projet utopique de reconstruction d'un monde placé cette fois sous le seul signe du spirituel.
Comme plus d'un artiste de l'avant-garde, il semble avoir cru fermement à cette impossible gageure. Après son retour en Russie, dès la fin de 1914, l'une de ses premières préoccupations est de faire publier en russe ses textes antérieurs, et notamment Regards qui, sous un rhabillage de surface, réaffirme, en octobre 1918, le même idéalisme fervent au cœur d'un pays dont pourtant la philosophie est maintenant officiellement celle du plus strict matérialisme... Mais le projet d'éditer Du spirituel dans l'art, lui, n'aboutira pas.
Chargé d'importantes responsabilités officielles, il fait passer au second plan sa propre peinture, dont la production se réduit sensiblement (aucun tableau à nouveau en 1918), pour se consacrer à une intense activité théorique, pédagogique, administrative (pour la réorganisation des musées notamment), appuyée par de nouveaux textes. Il espère notamment pouvoir abolir les cloisonnements antérieurs (entre les différents arts, les artistes des différents pays...) pour aboutir à une nouvelle « synthèse », et pense que cette « grande utopie » (c'est le titre, significatif, d'un de ses articles) va devenir réalité. La radicalisation croissante du milieu artistique lui-même ne laisse que peu de chances à cet immense effort, qui reste fondé sur les principes énoncés avant 1914. De plus en plus vivement contesté, notamment à propos du programme de l'Institut de la culture artistique (Inkhouk) à la fondation duquel il a participé, Kandinsky part définitivement pour l'Allemagne en décembre 1921, avec Nina Andreievskaïa qu'il a épousée en 1917 et qui sera sa compagne jusqu'à la fin de sa vie.
Parallèlement, son œuvre a vu surgir, sur sa « gauche » cette fois, de nouveaux adversaires. Le suprématisme de Malévitch et de ses disciples, qui se développe à partir de 1915, participe sans doute d'un idéalisme comparable, mais ses formes géométriques simples sur fond blanc apparaissent à bien des égards plus neuves et plus radicales. De même pour les différentes tendances du constructivisme, dont la géométrie froide et rigoureuse semble assurer, mieux que le lyrisme subjectif de l'avant-guerre, l'objectivité scientifique requise pour l'édification du monde nouveau. Et plus encore, à l'extrême gauche, pour l'art de la « culture des matériaux » prôné par Tatline, et qui va conduire en quelques années à une production purement utilitaire : Kandinsky ne peut qu'en rejeter en bloc le matérialisme et le dogmatisme sectaire. Mais sa peinture marque un temps d'hésitation devant les nouvelles formes d'abstraction géométrique (et quelques tableaux, non retenus dans le catalogue il est vrai, indiquent même un retour passager à la figuration la plus traditionnelle) : après un assagissement de la composition et un assourdissement des couleurs, la conversion va s'effectuer progressivement en effet, jusqu'au début des années 1920, pour aboutir à une peinture géométrique claire et vivement colorée que résument les grands tableaux de 1923, Composition VIII ou Trait transversal (Durchgehender Strich), et qui donne, pour l'essentiel, l'orientation de l'œuvre de Kandinsky pour les dix ans à venir. Malgré d'évidentes analogies de surface, il ne s'agit pourtant pas d'une adhésion au suprématisme : le support thématique reste celui de l'avant-guerre, et les données iconographiques, qui persistent dans plus d'une œuvre « à double lecture » (abstraite et figurative), assurent la continuité. En 1924, un tableau qui porte à son tour le titre révélateur de Regard sur le passé (Rückblick) reprend purement et simplement, en le géométrisant, un tableau important de 1913, Petites Joies (Kleine Freuden), et donne la mesure d'une plus fondamentale fidélité.
Appelé par Walter Gropius au Bauhaus, fondé en 1919 à Weimar (puis transféré à Dessau et à Berlin, où le peintre restera jusqu'à sa fermeture par les nazis en 1933, témoignant ainsi de sa foi persistante dans l'entreprise), Kandinsky retrouve dans un pays qui croit lui aussi avoir fait table rase du passé les conditions de mise en œuvre de la « grande utopie ».
Dans la nouvelle école, les paradoxes ne manquent pourtant pas. En principe la peinture de chevalet, jugée trop individualiste, n'a pas droit de cité dans un établissement dont le but ultime est la « construction », au service de laquelle doivent se mettre tous les arts : Kandinsky est d'abord nommé à la tête de l'atelier de peinture murale. Mais il ne travaillera lui-même qu'à deux réalisations de ce type : un projet pour un hall de musée (exposition de la Juryfreie, Berlin, 1922) et un salon de musique revêtu de céramique (également exposé à Berlin, en 1931). Et la mise en scène des Tableaux d'une exposition de Moussorgski (1928) est la seule occasion qui lui soit donnée de témoigner de son aspiration renouvelée à la synthèse des arts.
La peinture de chevalet continue pourtant, dans l'atelier personnel, et pendant les heures du travail libre. Ses éléments constitutifs font l'objet d'analyses approfondies (dessin analytique et séminaire sur la couleur) dans le « cours préliminaire » puis à la « classe de peinture libre », à partir de 1927. Kandinsky en résume l'apport dans plusieurs textes, dont le plus important est son livre Punkt und Linie zu Fläche (littéralement : « Point et ligne (rapportés) au plan »), publié en 1926 dans la collection du Bauhaus. Mais, et c'est un second paradoxe, on peut se demander comment la tentative pédagogique, qui a vocation scientifique, et universelle, peut se concilier avec le développement d'une œuvre aussi individualisée et si profondément ancrée dans la structure d'une personnalité. De fait, la théorie reste marquée par la préoccupation spiritualiste et, malgré le recours à la psychologie de la forme ou à des analyses qui anticipent largement sur la « sémiotique » contemporaine, guidée d'abord par l'intuition personnelle, ce qui vaudra à Kandinsky de vives attaques au sein même de l'école. Quant à son œuvre propre – que Kandinsky caractérise, pendant cette période, comme un « grand calme avec forte tension intérieure » –, il lui arrive parfois de subir le contrecoup du caractère expérimental de la recherche : tableaux plus froids, d'un dessin et d'une couleur plus sèche, et dont le systématisme pourrait finir par étouffer la spontanéité.
Plus généralement, la géométrie implique maintenant la substitution à l'espace fluide et homogène de l'avant-guerre d'un ensemble de figures distinctes du fond sur lequel elles se détachent, et pose ainsi le problème difficile de la structuration cohérente du tableau. Le recours renouvelé, et même renforcé, à l'allusion figurative pourrait être l'indice ici d'une difficulté qui n'est pas totalement résolue.
Avec l'irruption de plus brutales réalités, la fermeture du Bauhaus marque la fin du temps des utopies : l'aurore tant espérée n'est plus qu'une étroite bande claire, menacée d'étouffement, au milieu de Développement en brun (Entwicklung in Braun), le dernier tableau peint en Allemagne, en août 1933.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Paul BOUILLON : professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain à l'université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand
Classification
Médias
Autres références
-
DU SPIRITUEL DANS L'ART ET DANS LA PEINTURE EN PARTICULIER, Wassily Kandinsky - Fiche de lecture
- Écrit par Marcella LISTA
- 1 186 mots
- 1 média
La première ébauche d'une étude entièrement vouée à la couleur remonte à l'année 1904, alors que Kandinsky (1866-1944) était établi à Munich depuis huit ans. Ce petit texte inédit, intitulé Définition de la couleur, donne déjà la mesure d'une utopie universaliste : « Si la...
-
KANDINSKY (exposition)
- Écrit par Jean-Paul BOUILLON
- 1 169 mots
Depuis la mort de l'artiste en 1944, l'œuvre de Wassily Kandinsky n'a cessé d'être exposée dans le monde entier. La dernière grande rétrospective parisienne avait accompagné, en 1984, la donation de sa succession au Musée national d'art moderne. Du 8 avril au 10 août 2009, le Centre Georges-Pompidou...
-
ABSTRAIT ART
- Écrit par Denys RIOUT
- 6 718 mots
- 2 médias
...des habitudes acquises, mais elles rendaient compte aussi, à leur manière, d'un fait fondamental : une fracture majeure bouleversait le monde de l'art. Kandinsky a raconté comment lui apparut la possibilité d'une conception nouvelle : « J'arrivais chez moi avec ma boîte de peinture après... -
ART (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 284 mots
- 1 média
Une explication supplémentaire dans l’élucidation du génie nous est apportée au xxe siècle par le peintre Wassily Kandinsky (1866-1944) dans son essai théorique Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier (1911). Le peintre y développe le concept de « nécessité intérieure... -
BAUHAUS
- Écrit par Serge LEMOINE
- 4 463 mots
- 6 médias
Des maîtres aussi indépendants et personnels queKandinsky et Klee exercèrent sans doute une influence profonde au Bauhaus, mais celui-ci ne fut pas sans agir à son tour sur leur œuvre, qui montre bien une évolution semblable. Le milieu dans lequel ils vivaient – Klee et Kandinsky, qui cherchaient... -
BLAUE REITER DER
- Écrit par Étiennette GASSER
- 2 898 mots
- 5 médias
Munich est en pleine effervescence artistique au début du xxe siècle. Déjà, en 1892, des artistes se séparaient de l'Association munichoise et formaient la première sécession d'Allemagne. La revue Jugend, organe du Jugendstil, ou Art nouveau, ferment de rénovation, paraît en 1896. La...
- Afficher les 14 références
Voir aussi