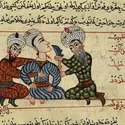HUMBOLDT WILHELM VON (1767-1835)
Article modifié le
Une biographie « explicite » permet de repérer l'appartenance effective de Humboldt à une période chargée d'événements qui ont remodelé la configuration politique et théorique de l'Europe. D'abord témoin passionné mais discret des renouvellements culturels de son temps (lisant Kant et correspondant avec Schiller et Goethe), il intervient directement dans la trame politique du début du xixe siècle en participant à la reconstruction de la Prusse (fondation théorique et pratique de l'université de Berlin) et à l'intense activité diplomatique provoquée par la disparition de Napoléon.
Finalement, il s'agit là d'aspects discontinus et peu pertinents d'une histoire personnelle qui nourrit, en marge des courants avoués, une préoccupation tenace et exclusive dont la dénomination ne saurait être énoncée en clair sans schématisation forcée. La grande affaire de Humboldt, c'est l'immense labeur consacré au langage, moins remarquable par l'ampleur du domaine (toutes les langues de la planète et de l'histoire recensées ou reconnues de son temps) que par la rigueur du projet : construire une théorie générale du langage en tant que foyer des opérations incessamment réitérées par quoi l'espèce humaine s'engendre comme humanité. Projet inouï en son temps (et sans doute encore aujourd'hui, surtout depuis l'émergence de la linguistique proprement dite). Retiré de toute autre affaire que de celle-là, Humboldt, pendant les quinze dernières années de sa vie, multiplie, réécrit les esquisses qui culminent dans le grand manuscrit inachevé au titre définitivement provisoire de : Sur la différence de construction du langage dans l'humanité et l'influence qu'elle exerce sur le développement de l'espèce humaine (Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, 1re éd. 1836).
Texte inachevé donc et plus encore régi par un ordre peu évident, ce qu'on traduit d'ordinaire par l'aveu trop satisfait d'avoir affaire à une « pensée difficile ». Pour essayer malgré tout de la déchiffrer, on partira de ses prémisses lointaines inscrites dans la Critique du jugement de Kant où il s'agit de mettre en œuvre le champ autonome fécondé par l'interaction dynamique du sensible et de l'intelligible. C'est, chez Humboldt, le problème du « caractère », résultante de l'étroite relation de l'idéal et de l'individuel, à l'œuvre dans l'art et dans l'histoire. Il y a là un modèle disponible dont doute la force latente va s'investir, à partir de 1800, dans la langue : « Le langage n'opère pas seulement à la manière d'un tableau par la corrélation des parties concomitantes, mais [...] à la manière d'une musique dans laquelle les timbres passés et en attente interviennent déjà dans le timbre présent par les renforcements et les effets qu'ils lui confèrent. »
Le travail des trente-cinq années suivantes va consister à rendre intelligible cette symphonie du langage qui nous institue incessamment. De là sans doute les tensions d'une écriture attentive à se plier aux harmoniques qui la sollicitent et qu'on dénaturera en la réduisant à une suite de thèses.
Le principe d'immanence. Le langage n'est pas composé d'éléments prédonnés ni décidé par une intention prédéterminante. Il est donc sans origine ni fin externes. De là, l'obligation faite au « linguiste » de se rendre réceptif à ses inflexions en refusant de lui plaquer un code de notions préétablies.
L'opérationnalité. Tout dans la langue est forme, et forme de forme, par réitération continuée. D'où la notion de « forme interne » qui ne fait qu'en expliciter l'idée. D'où surtout le caractère dynamique des interactions qui ne cessent de se provoquer mutuellement, faisant de la langue une construction (Bau) continuée.
Le principe de totalité. Entretenant en elle la raison de son être, la langue n'est pas partie du monde ; elle se fait son monde qui, toujours singulier, tend à se dépasser en direction d'autres mondes (les autres langues) et d'un horizon commun à tous (« le » monde). La langue est ainsi parcourue de part en part par un procès de symbolisation qui la fait valoir pour autre chose qu'elle-même, sans cesser d'être condition et assignation de cette « chose ».
L'historicité. Œuvre en cours, la langue ne cesse de se défaire et de reprendre, par une suite de ruptures et d'émergences qui maintiennent une effervescence génératrice d'histoire, c'est-à-dire d'absences et de présences alternées sans domination despotique d'un principe intemporel. Elle est toujours à venir.
En résumé, on a affaire à une entreprise consistant à délester le langage de sa substance assignée (instrument monté par Dieu ou produit par l'entendement humain) pour le renvoyer à la multiplicité de variations réitérées ; mais c'est, du même coup, pour la promettre à une mobilité et à une puissance qui en font l'équivalent d'un monde. Le langage est dès lors reconnu comme foyer de variations concertantes, à la fois indépassables et non suffisantes. « Le langage combine de façon si étonnante la convergence universelle et la spécialisation individuelle, qu'il est aussi juste de parler d'une seule langue propre à l'espèce humaine que d'une langue particulière propre à chaque individu. » La tâche du « linguiste » consiste à maintenir ouvert cet espace de jeu.
S'agit-il alors de « linguistique » ? Assurément non, dans la mesure où celle-ci n'a pu se constituer qu'en opérant des délimitations dont par la suite elle s'inquiète. Mais il ne s'agit pas non plus de « philosophie du langage », discours souverain sur une réalité clairement reconnaissable. Entre les deux (ou mieux, au-delà d'elles), l'œuvre de Humboldt témoigne à sa manière (peu entendue jusqu'ici) de l'invention d'un discours théorique rebelle autant à la suffisance métaphysique qu'aux réductions de la science.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre CAUSSAT : linguiste
Classification
Média
Autres références
-
INTRODUCTION À L'ŒUVRE SUR LE KAVI, Wilhelm von Humboldt - Fiche de lecture
- Écrit par Gabriel BERGOUNIOUX
- 806 mots
- 1 média
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) est né dans une famille de la noblesse prussienne, au moment charnière de la transition entre le rationalisme classique (il est un lecteur assidu de Kant) et l'apparition du romantisme. Élève du philologue F. A. Wolf, proche de Schiller, il s'intéresse à de nombreux sujets,...
-
CULTURE - Culture et civilisation
- Écrit par Pierre KAUFMANN
- 14 365 mots
- 2 médias
...(Dictionnaire... de Adelung, cité par Tonnelat d'après l'édition de 1793), l'irréductibilité du génie singulier de chaque peuple. De cette Kultur, ou Bildung, les frères Humboldt détermineront le statut comme symbolique, pour autant qu'ils lui donneront la singularité de la langue... -
HISTOIRE (Histoire et historiens) - Courants et écoles historiques
- Écrit par Bertrand MÜLLER
- 6 837 mots
- 1 média
...de l'histoire et des Lumières ; elle privilégie une démarche empirique, érudite et philologique, qui se fonde sur la critique méthodique des sources. Wilhelm von Humboldt (1867-1835), fondateur de la nouvelle université allemande, en a formulé les éléments théoriques qui se sont incarnés exemplairement... -
LANGAGE (FONCTIONS DU)
- Écrit par Catherine FUCHS
- 1 512 mots
La question des fonctions du langage, sur laquelle se sont penchés philosophes et grammairiens, est ancienne. Deux grandes traditions s'opposent en la matière : pour la première, la fonction fondamentale du langage consiste à permettre la représentation de la pensée ; pour la seconde, elle est d'abord...
-
STADE NOTION DE
- Écrit par Marie-Claude LAMBOTTE
- 1 126 mots
En tenant compte de l'arbitraire qui s'attache à toute tentative de définition d'un concept, dans la mesure où elle opère par réduction à partir des prémisses, il semblerait que la notion de stade présente deux applications bien distinctes autour desquelles se distribuent...
Voir aussi